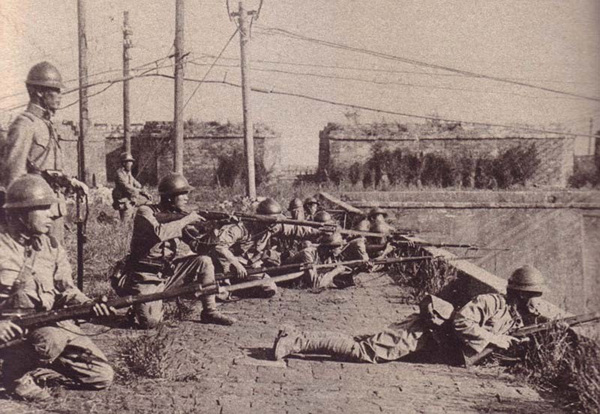Brace yourselves, historical documentaries are coming
L’étude de l’Histoire ne saurait se résumer uniquement à la lecture de livres et de revues scientifiques. De fait elle peut, et doit, s’ouvrir à d’autres médias, notamment la vidéo, au moins dans une dimension de popularisation du savoir historique. C’est dans cette perspective que je propose de déposer ici des documentaires sélectionnés par mes soins.
Mémo sur le choix des documentaires :
Les documentaires mis en ligne le sont suite à un visionnage de ma part, ce qui atteste, au moins à minima, leur qualité d’ensemble. Malgré cela, il n’en demeure pas moins que je presse chaque spectateur de ne pas perdre son esprit critique. En effet, certains documentaires pouvant être contestables sur des points de détails plus ou moins secondaires. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que, en dépit des qualités des différents reportages, cela ne saurait être que des mises en bouche. L’exploration plus approfondie des thèmes devra se faire par le recours à des ouvrages spécialisés ainsi que des articles de revues thématiques. Il est possible de trouver une liste de ces dernières ici.
En outre, pour plus de clarté, je dois mettre par écrit les différents critères qui président au choix d’inclure tel ou tel documentaire dans la liste. De fait, toutes les thématiques sont envisageables, depuis ce qui pourrait être considéré comme “sérieux” (histoire politique ou économique par exemple) à ceux que certains – aux esprits un peu étriqués – qualifieraient de “futiles” (histoire de la mode ou des cosmétiques par exemple). Le premier critère est donc la manière dont le sujet est traité et non la thématique en elle-même. Par ailleurs, je tends plutôt à choisir des documentaires dans lesquels les analyses des historiens sont mises en avant et le moins perturbées possible par des commentaires d’une quelconque voix-off. Dans le même état d’esprit je privilégie la présence des images ou sons d’époque comme support de l’argumentaire. Ainsi le spectateur peut accéder à des sources visuelles d’époque. Toutefois, dans certains cas, notamment pour les périodes les plus anciennes, cette exigence est plus difficile à maintenir et je dois donc m’accommoder de l’usage de la méthode du docu-fiction ou des reconstitutions.
Néanmoins, les documentaires donnant une large place aux témoignages des acteurs ne seront pas pour autant dédaignés. Certes, certains pourraient remettre en question cet intérêt pour les témoignages, notamment autour de l’idée que le recours à la source de première main sans prise de recul critique pourrait conduire à émotionnaliser le sujet plus que de l’intellectualiser. De même, avec la subjectivité que le point de vue d’un simple individu peut impliquer. Ou encore les interrogations sur la fiabilité du témoignage, certains discours, présentés comme des souvenirs, pouvant avoir été en partie reconstruits à posteriori. Toutefois, comme l’explique [1] intelligemment Alix Chapuis
[Le] témoignage n’a pas pour but de remplacer l’analyse historique mais de la compléter.
Ces documentaires ne seront donc pas ceux permettant de comprendre le plus finement et le plus clairement l’époque considérée, mais ils permettent de mettre en évidence – au moins en partie – la mentalité des acteurs en présence au moment des faits.
Pour conclure, par souci de synthèse, un tableau récapitulatif sera ajouté à chaque page, listant les documentaires selon plusieurs critères tels que la présence d’historiens, d’autres chercheurs en sciences sociales, de témoins, d’archives etc…
Méthode de classement :
En ce qui concerne le classement des documentaires, j’ai décidé, pour des raisons de praticité, de procéder sur des bases plutôt géographique et thématique, mais aussi chronologique. Il en sera comme suit.
D’abord quelques documentaires d’historiographie ou d’épistémologie, traitant de la pensée de certain(e)s historien(ne)s ou autres chercheurs. Ensuite, une disposition thématique où sont discutés des sujets vastes et/ou chronologiquement allongés. Il en sera ainsi, par exemple, de l’histoire des religions, du corps ou de la guerre.
Par la suite, le classement se fait plus géographique et ce à travers deux prismes principaux : le point de départ du territoire de l’actuelle France métropolitaine et un déroulement d’est en ouest en passant par l’Asie et les Amériques ainsi que l’inclusion des histoires passées dans les territoires nationaux, mutatis mutandis. De fait, le passé gaulois sera plutôt classé dans “Histoire de France”. Tout cela essentiellement par commodité et non comme l’expression d’un nationalisme quelconque ou de l’ignorance de la fluctuation des frontières. Ce sera donc plutôt un classement “d’histoires nationales”, mais avec la claire conscience de leurs propres limites et leurs propres faiblesses. Par ailleurs, des recoupements seront également opérés à travers des entités géographiques plus grandes, que ce soit l’Europe – de l’ouest, de l’est etc – , l’Afrique ou les Amériques. Cela a pour but de ne pas enfermer des documentaires aux visions transterritoriales et transnationales dans les carcans des nations actuelles. Par exemple, l’empire de Charlemagne ou l’histoire des relations entre Orient et Occident ne peuvent se comprendre qu’en faisant exploser les barrières mentales nationales. Il aurait été très réducteur – et surtout peu opératoire, donc encore plus arbitraire – de penser ces sujets dans ces cadres étriqués.
Je suis bien conscient du caractère totalement arbitraire du classement ainsi que de l’européocentrisme que tout cela constitue. C’est pour cela que j’ai décidé de ne pas pousser plus avant dans cette direction, notamment sur la question des chronologies. De fait, la caractérisation par exemple de “Moyen Age” ou de “Renaissance” ne se comprend dans sa réelle portée que pour le continent européen, le “Moyen Age japonais” s’étendant, par exemple, de la fin du XIIème siècle [2] jusqu’à la seconde moitié du XVIème siècle [3]. En outre, la chronologie pouvant être une donnée très fluctuante, selon les axes de recherche et les thématiques, des dénominations rigides telles que “Moyen Age” ou “Antiquité” recouvrent mal les variations et la non concomitance des chronologies, les mentalités évoluant plus lentement que les techniques ou les péripéties politiques. Même si ces termes trop larges seront soigneusement évités, il demeure que, au sein des découpages géographiques, un découpage chronologique – essentiellement politique – adapté à chaque espace sera esquissé.
Enfin, dans le cas d’histoires thématiques traitant d’un sujet en traversant plusieurs périodisations historiques et concernant un seul territoire – l’histoire de la diplomatie française ou de l’art en Chine, par exemple – , j’ai choisi de conserver la cohérence de l’ensemble narratif en regroupant les différents documentaires dans un onglet “Thématique”, au bas de chaque page, si besoin se faisait sentir.
Comme d’habitude si des contenus viennent à m’échapper, je suis joignable à l’adresse mail suivante : michel@lhistoirestuncombat.net. Idem, si certains veulent exposer des griefs contre quelques-uns des documentaires listés, en vue ou non d’une suppression, je suis tout à fait ouvert à la discussion.
EDIT 1/11/2019 : Pour des raisons de praticité et de logistique, les fichiers ont dû migrer d’une plateforme à une autre. Or, sur cette dernière il n’est plus possible de visionner directement en ligne. Le spectateur devra donc télécharger le documentaire pour ensuite le visionner. En cas de problèmes de compatibilité de certains formats de fichiers avec les lecteurs conventionnels (type Windows Media Player), je ne saurais trop conseiller de se tourner vers des alternatives plus performantes telles que VLC ou Pot player.
***Dernière mise à jour juin 2020***
Historiographie et épistémologie
Thèmes
Histoire des religions
Histoire culturelle
Histoire des idées
Histoire de l’éducation
Histoire de la jeunesse
Histoire du féminisme
Histoire de la guerre
Histoire des révoltes
Histoire du terrorisme
Histoire du crime organisé
Histoire judiciaire
Histoire des techniques
Archéologie
Histoire de l’art
Histoire économique
Histoire des diasporas
Histoire du corps
Histoire de l’alimentation
Histoire de la médecine
Histoire de la mort
Histoire mondiale
Histoire de l’Europe
Europe occidentale
France
Histoire chronologique
Thèmes et biographies
Belgique
Pays-Bas
Allemagne
Suisse
Autriche
Europe du Nord
Iles britanniques
Angleterre
Ecosse
Irlande
Scandinavie
Danemark
Norvège
Suède
Finlande
Europe du Sud
Péninsule ibérique
Espagne
Italie
Grèce
Malte
Europe centrale et orientale
Balkans
Croatie
Tchéquie
Pologne
Roumanie
Ukraine
Lituanie
Lettonie
Russie
Histoire du monde méditerranéen
Histoire du Proche et Moyen-Orient
Proche-Orient
Turquie
Liban
Palestine
Syrie
Jordanie
Moyen-Orient
Arabie Saoudite
Irak
Iran
Histoire de l’Afrique
Afrique du Nord
Maroc
Algérie
Tunisie
Egypte
Afrique de l’Est
Ethiopie
Soudan
Ouganda
Tanzanie
Afrique centrale
Centrafrique
Rwanda
République démocratique du Congo
Afrique de l’Ouest
Ghana
Afrique australe
Namibie
Zimbabwe
Mozambique
Afrique du Sud
Histoire du monde eurasiatique
Histoire de l’Asie
Asie centrale
Afghanistan
Turkménistan
Asie de l’Est
Chine
Népal
Mongolie
Corée
Japon
Histoire du monde indo-océanique
Histoire de l’Asie du Sud
Inde
Laos
Cambodge
Vietnam
Singapour
Histoire des Amériques
Amérique du Nord
États-Unis
Canada
Amérique centrale
Mexique
Guatémala
Caraïbes
Cuba
Haïti
Amérique du Sud
Colombie
Pérou
Bolivie
Argentine
Histoire du monde océanien
Australie
Nouvelle-Zélande
[1] “ONG THONG HOEUNG : J’AI CRU AUX KHMERS ROUGES. RETOUR SUR UNE ILLUSION – CR DE LECTURE D’ALIX CHAPUIS”, Indomémoires (30 janvier 2015)
[2] “Le Moyen Âge japonais”, Sciences humaines (26 novembre 2008)
[3] “Le Japon médiéval. Au temps des samouraïs”, Archéothéma 30 (Août 2013)